Je vous partage cet article de l'année passée sur Rinder
Arthur Rinderknech, de l'université du Texas aux titres en Challenger
Vainqueur de deux Challengers (Rennes et Calgary) en l'espace d'un mois, Arthur Rinderknech est le quatrième meilleur Français du début d'année (55e à la Race). Inconnu du grand public, le Français de 24 ans, passé du 1000e au 160e rang mondial en deux ans, nous raconte son parcours atypique.
Arthur Rinderknech est la révélation du début de saison sur le circuit secondaire. (A. Brebant/Presse Sports)
Quentin Moynet
03 mars 2020 à 08h00
« Vous venez de remporter deux Challengers en un mois (Rennes et Calgary) et tout le monde semble vous découvrir. Racontez-nous votre parcours...
Je suis parti aux États-Unis en 2014, à 18 ans, après avoir obtenu mon Bac S en France. J'avais un assez bon niveau de tennis, j'étais -15. J'avais fait quart de finale aux Championnats de France mais je n'étais pas assez bon. Je ne me sentais pas prêt mentalement pour aller jouer sur le circuit. C'est un monde vraiment difficile. Voyager tout seul, ça coûte très cher. Je n'avais pas encore le niveau et je n'étais pas prêt mentalement.
Pourquoi les États-Unis ?
C'était la meilleure option pour moi : continuer à étudier pour avoir un diplôme reconnu partout dans le monde et en même temps me donner des chances de progresser au tennis et, éventuellement, un jour me lancer sur le circuit si je me sentais prêt. J'ai eu la chance d'avoir une super université, Texas A & M à College Station. Avec de super coaches. J'ai réussi à progresser tennistiquement pendant mes quatre ans là-bas. J'étais régulièrement dans les cinq premiers du pays en universitaire et j'ai eu mon diplôme.
« On pense souvent que les États-Unis ça veut dire qu'on abandonne le tennis, qu'on y va pour faire la fête, mais je ne l'ai pas pris comme ça. C'était un travail dans l'ombre »
Quand vous quittez la France à 18 ans, rêvez-vous encore de devenir joueur de tennis professionnel ?
Je me dis que j'ai très envie de l'être mais je suis assez lucide, je me dis que je ne suis pas prêt, mentalement, psychologiquement et même en termes de niveau. C'était incohérent de me lancer à ce moment-là. Je me suis dit : je ne me prends pas la tête, je continue mes études, je donne le maximum sur le court tous les jours et on verra bien dans quatre ans. Si je suis prêt, si je suis toujours motivé et si j'ai le niveau.
On pense souvent que les États-Unis ça veut dire qu'on abandonne le tennis, qu'on y va pour faire la fête, mais je ne l'ai pas pris comme ça. Je sais que beaucoup de joueurs passés par le système universitaire sont très en réussite sur le circuit. C'était un travail dans l'ombre. J'étais un peu invisible. Mais, assez rapidement, j'ai montré que j'avais un niveau de 300e, 400e.
À quoi ressemblait votre quotidien au Texas ?
Ce n'était pas une vie de tout repos. On était tout le temps sous tension. On avait physique à 6 heures du matin pendant une heure ou deux. Derrière, deux, trois heures de cours. Puis une séance individuelle avec un coach. Déjeuner puis entraînement d'équipe pendant trois heures, soins, dîner et enfin deux heures d'études. 6h-21h tous les jours. Ça envoie ! Et pendant la saison tennistique, entre janvier et mai, on avait des matches par équipes tous les deux ou trois jours. Avec un très gros niveau.
Quelle était l'ambiance ?
Une sacrée ambiance. Ça aide. Ça donne des références pour le circuit. Quand on joue à domicile, on a un public de 1 500 ou 2 000 supporters qui sont comme des fous derrière nous, qui crient pendant les points. Et à l'inverse, à l'extérieur, on a 2 000 personnes contre nous qui nous huent, nous insultent à moitié, nous charrient. Ce n'est pas évident mais ça développe le mental. C'est un aspect très important dans le tennis d'aujourd'hui. Ça m'a aidé à grandir plus vite.
En 2018, vous vous lancez réellement sur le circuit. Comment cela s'est-il passé ?
J'avais un bien meilleur niveau. Ça m'a permis, à l'été 2018, de passer en trois mois de 1 000e à 400e mondial. J'ai eu l'aide de la Fédération qui me suivait quand j'étais aux USA. Ils ont vu que j'avais de bons résultats donc ils m'ont proposé leur aide. Ils m'ont entraîné pendant un an et demi, au Centre National d'Entraînement, à Paris. Je m'entraîne depuis janvier à Saint-Grégoire, en banlieue de Rennes, avec Sébastien Villette, mon coach, et Manuel Guinard, un très bon ami.
« J'ai de la réussite à l'heure actuelle. Il faut en profiter, ne pas oublier qu'il y aura des moments plus durs et qu'il faut continuer à travailler »
Quel est votre style de jeu ?
Je suis grand. J'essaye d'utiliser mon service et mon coup droit qui est puissant. Je suis très flexible, souple, ce qui me permet de bien me déplacer pour un grand. J'essaye d'être capable de défendre quand il faut. Il n'y a pas que l'attaque, même si mon jeu est basé là-dessus, mettre la pression au joueur, aller chercher mes points.
Votre mère, Virginie Paquet, est une ancienne joueuse professionnelle (116e mondiale en 1989) et votre père a été -15. Vous aident-ils au quotidien ?
Mon père est très proche. Je l'ai régulièrement au téléphone, avant ou après les matches. Ma maman m'a mis sur les courts de tennis vers cinq, six ans, mais aujourd'hui elle a un peu plus de recul, même si je l'ai au téléphone toutes les semaines et qu'elle me donne des conseils avec son expérience.
Quelle est la suite de votre programme ?
Ça fait trois semaines que j'enchaîne, une semaine aux USA, deux au Canada. Là je rentre en France. Je vais me reposer cinq, six jours. J'ai vraiment "tapé" sur mon corps, entre le simple et le double. J'ai besoin de récupérer. J'ai réussi à faire avec les petits bobos pendant deux semaines, mais là il faut du repos. Après je vais me remettre à l'entraînement. Je serai au challenger de Lille et de Saint-Brieuc plus tard dans le mois. La semaine d'avant, je ne sais pas encore.
Réalisez-vous que vous êtes 55e mondial à la Race, quatrième meilleur Français du début d'année ?
On en rigolait avec mon coach. Ça fait plaisir, mais je suis le même homme, ça ne change pas grand-chose dans mon quotidien. Je fais mon truc, je joue à fond et je prends du plaisir. J'ai de la réussite à l'heure actuelle. Il faut en profiter, ne pas oublier qu'il y aura des moments plus durs et qu'il faut continuer à travailler. »
Arthur Rinderknech, de l'université du Texas aux titres en Challenger
Vainqueur de deux Challengers (Rennes et Calgary) en l'espace d'un mois, Arthur Rinderknech est le quatrième meilleur Français du début d'année (55e à la Race). Inconnu du grand public, le Français de 24 ans, passé du 1000e au 160e rang mondial en deux ans, nous raconte son parcours atypique.
Arthur Rinderknech est la révélation du début de saison sur le circuit secondaire. (A. Brebant/Presse Sports)
Quentin Moynet
03 mars 2020 à 08h00
« Vous venez de remporter deux Challengers en un mois (Rennes et Calgary) et tout le monde semble vous découvrir. Racontez-nous votre parcours...
Je suis parti aux États-Unis en 2014, à 18 ans, après avoir obtenu mon Bac S en France. J'avais un assez bon niveau de tennis, j'étais -15. J'avais fait quart de finale aux Championnats de France mais je n'étais pas assez bon. Je ne me sentais pas prêt mentalement pour aller jouer sur le circuit. C'est un monde vraiment difficile. Voyager tout seul, ça coûte très cher. Je n'avais pas encore le niveau et je n'étais pas prêt mentalement.
Pourquoi les États-Unis ?
C'était la meilleure option pour moi : continuer à étudier pour avoir un diplôme reconnu partout dans le monde et en même temps me donner des chances de progresser au tennis et, éventuellement, un jour me lancer sur le circuit si je me sentais prêt. J'ai eu la chance d'avoir une super université, Texas A & M à College Station. Avec de super coaches. J'ai réussi à progresser tennistiquement pendant mes quatre ans là-bas. J'étais régulièrement dans les cinq premiers du pays en universitaire et j'ai eu mon diplôme.
« On pense souvent que les États-Unis ça veut dire qu'on abandonne le tennis, qu'on y va pour faire la fête, mais je ne l'ai pas pris comme ça. C'était un travail dans l'ombre »
Quand vous quittez la France à 18 ans, rêvez-vous encore de devenir joueur de tennis professionnel ?
Je me dis que j'ai très envie de l'être mais je suis assez lucide, je me dis que je ne suis pas prêt, mentalement, psychologiquement et même en termes de niveau. C'était incohérent de me lancer à ce moment-là. Je me suis dit : je ne me prends pas la tête, je continue mes études, je donne le maximum sur le court tous les jours et on verra bien dans quatre ans. Si je suis prêt, si je suis toujours motivé et si j'ai le niveau.
On pense souvent que les États-Unis ça veut dire qu'on abandonne le tennis, qu'on y va pour faire la fête, mais je ne l'ai pas pris comme ça. Je sais que beaucoup de joueurs passés par le système universitaire sont très en réussite sur le circuit. C'était un travail dans l'ombre. J'étais un peu invisible. Mais, assez rapidement, j'ai montré que j'avais un niveau de 300e, 400e.
À quoi ressemblait votre quotidien au Texas ?
Ce n'était pas une vie de tout repos. On était tout le temps sous tension. On avait physique à 6 heures du matin pendant une heure ou deux. Derrière, deux, trois heures de cours. Puis une séance individuelle avec un coach. Déjeuner puis entraînement d'équipe pendant trois heures, soins, dîner et enfin deux heures d'études. 6h-21h tous les jours. Ça envoie ! Et pendant la saison tennistique, entre janvier et mai, on avait des matches par équipes tous les deux ou trois jours. Avec un très gros niveau.
Quelle était l'ambiance ?
Une sacrée ambiance. Ça aide. Ça donne des références pour le circuit. Quand on joue à domicile, on a un public de 1 500 ou 2 000 supporters qui sont comme des fous derrière nous, qui crient pendant les points. Et à l'inverse, à l'extérieur, on a 2 000 personnes contre nous qui nous huent, nous insultent à moitié, nous charrient. Ce n'est pas évident mais ça développe le mental. C'est un aspect très important dans le tennis d'aujourd'hui. Ça m'a aidé à grandir plus vite.
En 2018, vous vous lancez réellement sur le circuit. Comment cela s'est-il passé ?
J'avais un bien meilleur niveau. Ça m'a permis, à l'été 2018, de passer en trois mois de 1 000e à 400e mondial. J'ai eu l'aide de la Fédération qui me suivait quand j'étais aux USA. Ils ont vu que j'avais de bons résultats donc ils m'ont proposé leur aide. Ils m'ont entraîné pendant un an et demi, au Centre National d'Entraînement, à Paris. Je m'entraîne depuis janvier à Saint-Grégoire, en banlieue de Rennes, avec Sébastien Villette, mon coach, et Manuel Guinard, un très bon ami.
« J'ai de la réussite à l'heure actuelle. Il faut en profiter, ne pas oublier qu'il y aura des moments plus durs et qu'il faut continuer à travailler »
Quel est votre style de jeu ?
Je suis grand. J'essaye d'utiliser mon service et mon coup droit qui est puissant. Je suis très flexible, souple, ce qui me permet de bien me déplacer pour un grand. J'essaye d'être capable de défendre quand il faut. Il n'y a pas que l'attaque, même si mon jeu est basé là-dessus, mettre la pression au joueur, aller chercher mes points.
Votre mère, Virginie Paquet, est une ancienne joueuse professionnelle (116e mondiale en 1989) et votre père a été -15. Vous aident-ils au quotidien ?
Mon père est très proche. Je l'ai régulièrement au téléphone, avant ou après les matches. Ma maman m'a mis sur les courts de tennis vers cinq, six ans, mais aujourd'hui elle a un peu plus de recul, même si je l'ai au téléphone toutes les semaines et qu'elle me donne des conseils avec son expérience.
Quelle est la suite de votre programme ?
Ça fait trois semaines que j'enchaîne, une semaine aux USA, deux au Canada. Là je rentre en France. Je vais me reposer cinq, six jours. J'ai vraiment "tapé" sur mon corps, entre le simple et le double. J'ai besoin de récupérer. J'ai réussi à faire avec les petits bobos pendant deux semaines, mais là il faut du repos. Après je vais me remettre à l'entraînement. Je serai au challenger de Lille et de Saint-Brieuc plus tard dans le mois. La semaine d'avant, je ne sais pas encore.
Réalisez-vous que vous êtes 55e mondial à la Race, quatrième meilleur Français du début d'année ?
On en rigolait avec mon coach. Ça fait plaisir, mais je suis le même homme, ça ne change pas grand-chose dans mon quotidien. Je fais mon truc, je joue à fond et je prends du plaisir. J'ai de la réussite à l'heure actuelle. Il faut en profiter, ne pas oublier qu'il y aura des moments plus durs et qu'il faut continuer à travailler. »
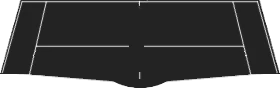



Comme quoi les conditions de préparation peuvent faire la différence. Je savais pas qu'Arthur est le fils de Virginie Paquet. C'est clair que quand on a un exemple sous les yeux ça motive à pratiquer tôt aussi...
Merci Bombom, très intéressant ;)
Merci, c'est sympa !